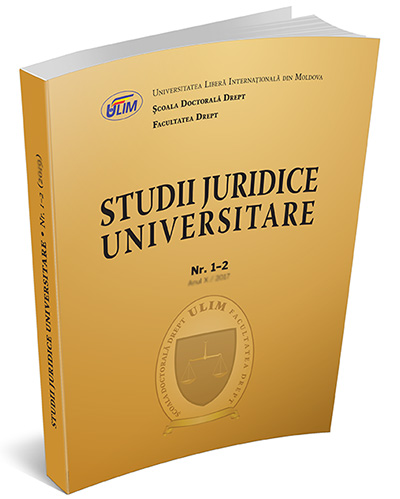GAMURARI Vitalie, docteur es droit, maitre de conférence, ULIM
|
|
La présente étude propose une analyse du processus de la mise en њuvre de la justice transitionnelle dans une zone qui a été fortement affecté par une série de conflits armés au caractère international et non international, à la fin du XXe siècle — l’ex-Yougoslavie. Les effets de ce conflit « Balkans » sont assez difficiles — la carte politique de l’ex-Yougoslavie a été essentiellement révisée, mais le rétablissement de la confiance entre les « nouveaux voisins » sera prolongé. Cette étude représente un intérêt même pour la République de Moldavie, une société qui, après l’effondrement de l’ex-URSS, s’est confrontée avec le déclenchement d’un conflits armés, moins sanglant que celui dans les Balkans, mais qui a également divisé la société en les nostalgiques de l’ancien régime et ceux qui désirent implémenter des vraies valeurs démocratiques européennes, y compris l’intégration européenne. Mots-clés: justice transitionnelle, conflit armé, ex-Yugoslavie, tribunal, crimes de guerre. |
|
|
|
Aplicabilitatea justiţiei tranziţionale în societăţile post conflictuale prin prisma „sindromului balcanic“ (Partea II) Studiul în cauză îşi propune o analiză a procesului de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale într-o zonă care a fost puternic afectată de o serie de conflicte armate cu caracter internaţional şi non-internaţional la finele secolului XX — fosta Yugoslavie. Efectele acestui conflict „balcanic” sunt destul de dure — a fost esenţial „revăzută” harta politică a fostei Yugoslavii, iar restabilirea încrederii între „noii vecini” va fi de lungă durată. Studiul în cauză prezintă interes şi pentru Republica Moldova, societate care după destrămarea fostei URSS, s-a ciocnit cu declanşarea unui conflict armat, deşi mai puţin sângeros ca cel din Balcani, dar în egală măsură a divizat societatea în cei nostalgici pentru fostul regim şi cei ce doresc implimentarea adevăratelor valori democratice europene, inclusiv integrarea europeană. Cuvinte-cheie: justiţie tranziţională, conflict armat, ex-Yugoslavia, tribunal, crime de război. |
|
La différenciation du droit applicable aux forces rebelles et aux groupes criminels dans le cadre des conflits armés dans le concept de la justice transitionnelle
On peut admettre que de certains groupes criminels organisés peuvent être considérés comme des groupes armés organisés, ils peuvent être responsables de la criminalité internationale. En conséquence, même si les propositions relatives à la création d’un tribunal international pour juger les affaires de terrorisme et de trafic de drogue ont échoué, les actions de ces groupes peuvent révéler le droit pénal international, en particulier le Statut de Rome.
A la première vue, des actes tels comme le terrorisme, le crime organisé ou les activités des groupes organisés ne constituent pas généralement le crime de génocide au sens de l’article 6 du Statut de Rome, car ils ne sont pas commis dans l’intention de « génocide » à « détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».1 Dans de certaines régions, comme par exemple la forêt amazonienne, les groupes criminels impliqués dans toutes sortes de trafic illicite peuvent d’une façon délibérative exterminer des groupes formés d’Indiens qui avaient défendu leur territoire contre les intrus.
Pour l’application de l’ar.7.1 du Statut de Rome le crime contre l’humanité signifie « l’un des actes mentionné ci-après lorsqu’il est commis dans une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile ». Les documents cités compennent des crimes qui sont commis meme par des organisations criminelles comme: meurtre, extermination, soumission à l’esclavage, privation de la liberté physique, torture, viol, etc. Le Statut de Rome définit la « soumission à l’esclavage » comme « l’acte d’exercer contre une personne un ou un ensemble des attributs liés aux droits de propriété, y compris dans le cadre du trafic des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ».2 L’Article 7.2 dispose « par l’attaque dirigée contre une population civile on comprend le comportement qui consiste à commettre de plusieurs actes visés au paragraphe 1, contre toute population civile, dans l’application ou en faveur de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ».
Cette disposition stipule que les crimes contre l’humanité peuvent être commis par des entités non étatiques.3 Dans le même temps, ce que nous entendons par « organisation » au sens de l’art.7.2 est discutable. Il y a une tendance à ne pas utiliser dans ce cas le critère applicable « aux groupes armés organisés », mais en fixer d’autres, tels comme le pouvoir de la force comparables à ceux des institutions étatiques.4 Même si cette disposition complexe ne peut être analysée en détail dans notre cas, il est évident que les groupes du crime organisé ne satisfont généralement pas une telle condition.
À base de l’art.8.2.f) du Statut de Rome sont également considérées les crimes de guerre et autres violations graves des lois et des coutumes de guerre, applicables dans le cadre des conflits armés non internationaux, des conflits armés qui opposent d’une façon étendue, sur le territoire d’un Etat, les autorités gouvernementales de cet État et des groupes armes organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
Ainsi donc, le droit pénal international peut être appliqué dans des circonstances exceptionnelles, aux actes commis par des groupes criminels organisés qui peuvent être poursuivis comme des crimes par la CPI ou d’autres tribunaux internationaux ou nationaux. Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui on connait plus de formes qui permettent l’entrée de la criminalité organisée dans le cadre du droit pénal international. Immédiatement après le déclenchement des conflits dans l’ex-Yougoslavie dans les années 1990, grâce au fait que la compétence du TPIY a été établie, la communauté internationale a pris des mesures pour restaurer et étendre l’autorité judiciaire internationale dans les pays en transition. Ainsi, par exemple, la Cour de Bosnie-Herzégovine a été créée en 2002, qui a le pouvoir général pour juger les crimes de guerre, mais également le crime organisé. En effet, la violence des gangs organisés ou d’autres actions des groupe organisées déterminent une responsabilité pénale individuelle par l’application du droit national, mais cette responsabilité est essentiellement déclenchés par le droit pénal international.
Dans le cadre du « droit pénal international par une nouvelle génération », la lutte contre le crime organisé est détenue à parité par l’établissement d’une autorité judiciaire dotée des pouvoirs au niveau national par le respect des conditions préalables à toute accusation de la violence en bandes organisées ou des comportements criminels qui relève du droit pénal international. A la meme fois, il faut également tenir compte du cadre réglementaire établi par le droit international humanitaire et le cadre réglementaire qui assure la sauvegarde des droits de l’homme.
Faire façe au crime organisé et à la violence dans les bandes représente une provocation du point de vue théorique et pratique, parce que ce sont des fénomènes, des questions extrêmement complexes et dynamiques. Bien que le législateur national réagit différemment selon les caractéristiques qu’on a définies, la lutte contre le crime organisé, les bandes et la violence des bandes organisées fait de plus en plus l’objet d’une réglementation internatonale qui prend la dimension transnationale du crime organisé et vient de confirmer la volonté des États de coopérer plus efficacement et d’harmoniser les législations nationales. Un cadre international complexe a été établi qui malheureusement n’est pas encore universellement reconnu et n’est pas mis en њuvre. En réalité, le recour à la force en vertu du droit international ne peut avoir lieu que dans le cas dans lequel les actes criminels peuvent etre imputables à un État. Dans des circonstances exceptionnelles, cependant, le crime organisé et la violence dans des bandes organisées peuvent entrer dans le champ de l’application du droit international humanitaire et du droit pénal international. Mais ces situations sont conditionnées par le fait que les groupes criminels sont devenus des organisations qui ont le pouvoir ou des structures similaires aux Etats.
Avant d’accepter que des groupes criminels pourraient être considérés comme des groupes armés organisés, ceux-ci pourraient être soumis à la responsabilité pour les crimes internationaux. Par conséquence, même si les propositions relatives à la création d’un tribunal pour juger les affaires qui consernent le terrorisme et le trafic de drogue au moment n’ont pas réussi,5 les actes commis par ces groupes peuvent relever du droit pénal international, en particulier les dispositions du Statut de Rome (1998).6 Cependant, le meme approche se heurte principalement d’un « long » dialogue sur la démarcation de démarcation entre le droit pénal international et le droit pénal international.
Partant du fait que, traditionnellement, quand il s’agit du droit pénal internqtional, on compred habutellement le terme « droit pénal comparé », alors que le droit pénal international reflète en grande partie l’évolution et la codification le domaine de la responsabilité dans le droit humanitaire internationale. Or, tout ce processus doit etre envisagé dans son integrité — à partir de la reconnaissance du caractère coutumier / impératif des « règles et coutumes de la guerre » dans leur formule de codage « violations graves des Conventions de Genève » et enfin « crimes de guerre » le terme universellement accepté aujourd’hui.7 Dans ce cas, en référence aux effets que la pratique juridique a eu et meme en a dans les Balkans, nous prenons le risque de supposer que, avant les années 80 du XXe siècle, le terme « crimes de guerre » était accepté au niveau d’ une doctrine puis la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie l’a confirmé meme du point de vue de la pratique judiciaire. Même si le précédent judiciaire n’est pas reconnu comme une source de droit pénal, y compris du droit pénal international, la réalité semble être un peu différente. Sous l’influence de la common law, la pratique juridique, y compris en droit pénal international, a un rôle de plus en plus important.
Il n’y a pas quelque chose de nouveau si nous déterminons que la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg a influencé le procès de la codification du droit pénal international, ce qui a été confirmé meme par la résolution no. 95 (1946) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette résolution a reconu les principes du droit pénal international déclarés par le Tribunal de Nuremberg. Par la suite, en dépit de la « guerre froide » a « gelé » l’evolution de l’institution de la responsabilité de l’institution dans le droit international humanitaire, cependant, la dernière décennie du XXe siècle a permis sa renaissance. Avec regret, mais nous devons reconnaître que cette renaissance a été assurée par le déclenchement des crise majeure avec des effets désastreux tels que l’effondrement de l’URSS et de la Yougoslavie, le dernier cas est caractérisée par une série de conflits armés sanglants.
Les solutions par rapport aux personnes déplacées à l’intérieur dans la vision de la justice transitionnelle
Les conflits déclenchés sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ont abordé une autre question importante — la situation dans laquelle se trouvent les personnes déplacées, dont le statut jusque-là était moins abordés au niveau international. Ce problème est particulièrement caractéristique aux pays confrontés à des conflits ethniques, comme par exemple celui de l’ex-Yougoslavie et dans le Caucase (Karabakh, Abkhazie, Ossétie), mais elle n’évite ni les pays qui connaissent des conflits politiques, tel comme le cas de la République de la Moldavie. Les personnes déplacées à l’interieur en absence d’une réglementation au niveau national et international sont défavorisées, il est meme étrange que cela puisse paraître, en ce qui concerne les réfugiés, dont le statut est régi par la Convention de Genève de 1951.
Rappelons que la maltraitance envers des personnes déplacées à l’intérieur du pays ont longtemps été des priorités pour les grandes puissances du Conseil de sécurité des Nations unies. À présent, selon des calculs il existe plus de 27 millions de personnes déplacées à l’intérieur, dépassant le nombre de réfugiés officiellement reconnus.8 Les situations au Darfour, le Soudan et la République démocratique du Congo ont montré récemment que l’extrême vulnérabilité des civils ne conduit pas automatiquement à une intervention en leur faveur. Rappelez-vous juste que cela se réfère aux premières années après la fin de la « guerre froide ». En Irak, le gouvernement de Saddam Hussein a été armé et aidé notamment par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au cours des années 80 du XX siècle, en dépit de plusieurs rapports crédibles qui concernent le déplacement systématique des minorités tel comme l’exemple des Kurdes du nord du pays.
Même la répression brutale des révoltes chiites et kurdes au mois de mars 1991 n’a pas provoqué au début la réaction en faveur des populations civiles menacées. En Bosnie, les plus graves nettoyages ethniques, à l’exception de Srebrenica, ont eu lieu dans la période entre avril et juillet 1992. En dépit de l’expérience du conflit armé en Croatie et la présence des casques bleus à Sarajevo, les multiples informations concernat les exactions des paramilitaires serbes, des appels du CICR du UNHCR, le Conseil de sécurité n’a pas réagi. De même, au Rwanda, les membres du Conseil de sécurité ont ignoré les avertissements sur la planification d’un génocide. Au moment du déclanchement des massacres, en avril 1994, le nombre des casques bleus situés à Kigali a été réduit de manière significative, et leur mandat a subi des changments.9 Enfin, en 1998, pendant la première année du conflit ouvert au Kosovo, les chefs des gouvernements des Etats de la occiidentale espérait aux négociations avec le gouvernement de Belgrade. De là jusqu’en mars 1999 les refugiés albanais ont été encouragés à retourner dans leurs villages détruits, ou au moins rester dans le pays. En mars 1999 l’entrée de l’OTAN dans le conflit a provoqué le retrait brutal des observateurs de la part de l’OSCE, dont la mission consistait à surveiller le procès du cessez- du -feu signé en Octobre 1998 et en assurer à la population civile. En conséquence, des centaines de milliers des personnes déplacées à l’interieur avaient été abandonnés.10
Il est à noter que dans le cas de l’ex-Yougoslavie, juste comme dans le cas de l’Irak et le Rwanda, le problème des personnes déplacées à l’inerieur devient l’objet des négociations diplomatiques, entre temps les Etats voisins ont été contraints de fermer leurs frontières devant un exode massif des refugiés. En Juillet 1992, la Croatie a fermé ses frontières aux réfugiés bosniaques, provoquant un dialogue sur ce sujet en Europe.11
Dans le cadre de certaines importantes conférences sur le conflit en Yougoslavie en 1992, Linda Chalker, s’exprimant au nom de l’Union européenne, a déclaré qu’elle considérait que la meilleure façon de minimiser le problème de la migration est d’essayer d’arrêter l’exode des personnes déplacées, en fournissant une assistance suffisante qui leur permettrait de leur assurer la sécurité sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.12
Dans ce cas, l’aide humanitaire est clairement conçu comme un moyen de la politique migratoire. Ainsi, en automne de 1992, l’idée des zones de sécurité humanitaire en Bosnie a été invoquée comme la solution possible pour les prisonniers de Bosnie, libérés des camps serbes, pour lesquels le CICR n’avait pas trouvé les pays à les recevoir.13 Quelques mois plus tard, au printemps de 1993, l’offensive serbe en Bosnie orientale a placé la communauté internationale devant deux dilemmes — la ville assiégée Srebrenica ne pouvait plus résister. Il falait décider — soit à intervenir, soit à accepter l’évacuation totale et ainsi abandonner les efforts diplomatiques de M. Vance et Owen. Par conséquent, Srebrenica a été déclarée « zone humanitaire sûre ». De cette façon, il est clair que, en 1991 et 1992, le démarrage d’une assistance humanitaire in situ avait comme l’objectif la limitation de l’exode ou l’évacuation des civils.
Il fallait donner une réponse à la question « sous quelle forme que ce processus soit mis en place ». Offrir de nouvelles formes de sécurité dans certains pays conflagrants des conflits armés était donc une réponse imaginée des pays occidentaux, comme un impasse diplomatique contre les nettoyages ethnique en Bosnie. Cette protection internationale a été offerte au lieu d’une hospitalité inexistante. Elle a été conçu avant tout comme une stratégie par l’intrermediaire duquelle on devrait limiter les souffrances, qui à son tour pouvait mener inévitablement à limiter la fuite. Cette approche, quand l’aspect humanitaire sert des objectifs de sécurité et de stabilité, entre-temps avait des conséquences imprévisibles, souvent dramatiques.
La premère conséquence de l’aspect humanitaire de l’ordre de la sécurité est le fait que la protection internationale ne se rapporte pas en grande partie aux personnes, mais aux certains endroits, aux zones tampons, aux frontières menacée. Les délais couramment utilisés dans le cadre de la politique respective sont les suivants: espaces humanitaires, zones de sécurité, voies de sécurité, zones d’air exclusifs, en se concentrant sur les zones où le niveau de risque doit être réduit ou contrôlé. Les forces de protection des Nations Unies (FORPRONU) ont été créées à l’origine pour maintenir l’ordre dans des régions de l’est de la Croatie. Ultérieurement en Bosnie, les zones de sécurité ont été bien définies en fonction de leur valeur stratégique. L’importance des négociations de l’ordre géopolitique sont en contraste avec l’absence des débats sur la protection des personnes impliquées. Il en résulte le résultat — les routes et les convois ont été mieux protégés que les victimes du conflit.
Le second aspect de ces zones protégées est le manque de la liberté de la circulation. En Bosnie, malgré le fait que Srebrenica fut déclarée la zone de sécurité, toute évacuation a été stopée, en dépit du fait que le petit endroit étouffait d’un grand nombre des réfugiés des localités voisines. Elle se transformait en un vaste camp assiégé, entièrement dépendant de l’aide internationale.14 Des couloirs humanitaires, comme celui organisé dans le cas de Sarajevo avaient des autres buts que la livraison de la nourriture, à l’exception de la possibilité des évacuations, à l’exception de quelques cas médicaux. En résumé, la création des zones de sécurité permet de grouper les civils et de limiter leur chance de quitter les zones de conflit comme par exemple de demander l’asile à l’étranger ou dans leur propre pays. La forme sous laquelle les gouvernements occidentaux insistaient sur le droit de rester et de s’opposer à l’épuration ethnique ne doit pas masquer le fait que les personnes déplacées n’avaient pas le choix et devaient rester en place dans des circonstances très dangereuses.
Le troisième aspect vient de completer les deux premiers. L’objectif de l’action internationale est d’arrêter l’exode, le contrôle des déplacements de population a comme la priorité la sécurité des personnes. Pas une seule fois les troupes de l’ONU ont été contraints de coopérer avec les dirigeants de ces populations, sans tenir compte de leur attitude envers les droits de l’homme. Ainsi, les militaires, parlementaire, les traficants, etc. étaient légitimes par leur statut d’intermédiaires entre les civils et les casques bleus des ONG humanitaires.
En conséquence, les zones de sécurité sont rapidement transformées en centres de contrebande, de crimes et de persécution des personnes qui ont des opinions différentes de celles promues par les leaders respectifs. Cette violence interne a été aggravée par les attaques de l’extérieur. L’attaque sur la localité Srebrenica en Bosnie en 1995, n’a pas été arrêtée par les casques bleus y stationnés. Plusieurs milliers d’hommes bosniaques ont été séparés de leur famille à l’intérieur de la base de la FORPRONU à Potocari avant d’être exécuté. En outre, juste Tadeusz Mazowiecki, le représentant de l’ONU pour les droits de l’homme en Bosnie a démissionné après ce massacre.
Les événements en Bosnie, plus exactement dans l’ex-Yougoslavie, à coté des tragédies des autres régions sousmentionnées telles comme le Darfour, Rwanda, Congo etc ont influencé l’ONU et ont contribué à la création des principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement interne, publiés en fevrier 1998.15 A l’absence du caractère d’un accord international ces principes ont juste la tache d’encourager les Etats, les forces militaires et les autres participants à respecter les règles humanitaires harmonisées.
Le conflit au Kosovo est venu comme un défi pour le nouveau guide. En 1998 et au début de 1999 les mécanismes de protection ne fut pas mis. Les souffrances des personnes déplacées avaient été minimisées alors que la communauté internationale cherchait un règlement négocié avec le gouvernement de Slobodan Milosevic. Avec l’entrée en conflit avec l’OTAN, la question de la persécution des personnes à l’intérieur a été rendue publiquement, en particulier dans le cadre des conférences de la presse quotidienne. Également le retrait des terrains des observateurs de l’OSCE et de toutes les agences humanitaires n’ont pas permis la protection des civils de la persécution de la part des paramilitaires. Ce conflit a fait un vrai désordre, non seulement parmi les réfugiés cloutés l’Albanie et la Macédoine, mais aussi parmi des centaines de milliers des personnes qui sont restés dans les limites des frontières du pays. D’autre part, le placement des forces internationales autour de l’Armée de libération du Kosovo a menacé des civils de l’origine serbes. La victoire des alliés a entraîné le nettoyage ethnique massif des Serbes organisé par des paramilitaires albanais. De ce fait, le conflit au Kosovo a mis en évidence les limites du système de protection des personnes déplacées mis en place par les Nations Unies.
Le problème des personnes déplacées à l’iterieur ne peut être étudié sans examiner la question de la migration forcée. La plupart des experts reconnaissent les conséquences humaines dramatiques de la fermeture des frontières par les pays voisins. En se référant à l’ex-Yougoslavie, cela reflète la position des Etats occidentaux. Dans ce cas-ci, nous pensons que la situation des personnes déplacées était payée par l’intervention politique, dont l’objectif était de maintenir les civils dans leur propre pays à cette période compris par les flammes de la guerre. Dans de telles circonstances cette Polirem ressemble plus à des pertes réelles de prisonniers. En réalité, les victimes du nettoyage ethnique en Bosnie n’ont pas bénéficié du droit de rester, telle comme ils étaient revendiqués, mais ils ont été contraints de rester.
Conclusion
A la suite de l’étude effectuée on peut constater que la situation post-conflit dans les Balkans a augmenté l’intérêt pour la mise en њuvre de la justice transitionnelle. Cependant, il semble naturel que ce processus prend du temps et reflète les aspirations des futures générations pour établir un climat de la confiance mutuelle. Le syndrome des Balkans fera écho longtemps pour les sociétés européennes qui croyaient naïvement que la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale ne sera jamais répétée, et les crimes de ce genre commis pendant cette période sont inimaginables dans la vision d’une société qui a évaluée pendant des siècles et qui a atteint un niveau du développement élevé. Mais, malheureusement, la réalité est d’une nature différente. Personne ne pouvait imaginer en 1984, lorsque les Jeux olympiques ont eu lieu à Sarajevo, que c’est seulement dans moins de 10 ans, cette belle ville se transformerait en ruines, et ses rues peuvent être confondues avec celles des villes européennes pendant la période de la Seconde guerre mondiale. Même si l’infrastructure peut être restaurée, la mémoire de la société en passant par ce conflit restera affectée pendant une longue période. Les Allemands ont eu besoin plus de 20 ans de se réconcilier moralement avec ses anciens ennemis, mais les hommages rendus par l’ancien kancelária allemand Villi Brand devant le monument aux victimes du ghetto de Varsovie ont eu des réactions controverses dans la société allemande. Voici juste un exemple. La génération des années 80 du XXe siècle garde bien à l’esprit la fameuse équipe nationale de basket de l’Yougoslavie et ses légendes — le croate Drajen Petrovic et le serbe Vlade Divac, qui, ensemble, faisaient des merveilles sur le terrain. Éclatement sanglant de la Yougoslavie et le conflit en 1991 entre la Serbie et la Croatie ont fait les anciens amis deviennent des ennemis sans aucune chance de parvenir à un accord, notamment en raison du décès en 1992 du croate Drajen Petrovic. Les sportifs, desquels tout le pays était fier, un instant sont devenus otages des politiques nationalistes de leurs Etats.
L’achèvement de la phase active du conflit des Balkans avec l’implication directe des forces de l’OTAN, a permis la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle, dont les effets sousmensionnés, malheureusement, seront observés plus tard. Dans le cadre de ce processus, il est devenu possible que les mères, les soeurs, les épouses apprennent le destin des enfants, des frères, des maris, même si dans de nombreux cas, ils étaient morts. Les spécialistes du CICR ont mentionné pas seulement une fois qu’il y des sociétés qui ne veulent pas promouvoir les normes qui prévoient des règles de deuil et des certaines traditions religieuses.
La création des commissions pour la Vérité, des Commissions d’enquête, apporter des excuses publiquement etc. ont comme objectif d’informer la société, de réviser (dans un sens correct) l’histoire et d’apprécier d’un mode les événement du passé. À cet égard, un rôle particulier est accordé à la Commission de Conciliation, comme le temps passe par le sentiment et le désir de se venger, et les parties dans de telles circonstances deviennent disponibles pour démarrer le processus des négociations afin de trouver un dénominateur commun.
L’étude de la pratique des Etats de la composition de l’ex-Yugoslavie représente un inéret disscutable pour les sociétés post-conflits, même pour la République de Moldavie. En dépit du fait que les situations de l’ex-Yugoslavie et celles de la République de Moldavie sont substantiellement différentes, le conte tenu de la nature et l’ampleur des conflits et l’implication massive dans le premier cas de la communauté internationale, mais certains clauses, méthodes et moyens peuvent être appliquées par analogie. C’est surtout il s’agit des réformes entreprises dans des divers domaines, y compris dans le système judiciaire, éducatif et informationnel.
1 Pour une étude plus profonde de voir: Kai Ambos. What does ‘intent to destroy’ in genocide mean? International Review of the Red Cross. Vol.91. Nr.876. December 2009, pp.833-858 http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-876-ambos.pdf (consultat la 13.09.2012).
2 Le Statut de Rome, art.7.2c).
3 Voir également: Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c. Tadić, Arret relatif a l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (chambre d’appel), aff aire n° IT-94-1-AR/, 2 octobre 1995, para.654-655 http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm (consulté le 16.09.2012).
4 Pierre Hauck et Sven Peterke. Le crime organisé et la violence en bande organisée dans le droit national et international. Revue Internationale de la Croix-Rouge. Volume 92. Sélection française 2010, p.250. http://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-4054.pdf (citat la 03.09.2012).
5 Voir les discussions sur la création d’un tribunal pour juger les affaires de terrorisme: Mondial: Pour revendiquer la création d’un tribunal international contre le terrorisme http://www.wluml.org/fr/node/1708 (consulté le 16.03.2013).
6 Voir: art.8.
7 Voir: Gamurari V., Barbăneagră A. Crimele de război. Chişinău: Reclama SA. 2008. — 500 p.
8 Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2010 (March 2011) http://www.internal-displacement.org/publications/global-overview-2010 (consulté le 15.03.2013).
9 Voir la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU nr.912 du 21.04.1994 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/912(1994) (consulté le 22.03.2013).
10 Voir: Roberta Cohen and David A. Korn. Failing the internally displaced. In: Forced Migration Review. Learning from Kosovo, nr.5, Août 1999, p.11-13 http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR05/fmr5full.pdf (consulté le 20.03.2013).
11 Voir: A Comprehensive Reponse to the Humanitarian Crisis in the former Yugoslavia. UNHCR Report, 24 July 1992, HCR/IMFY/1992/2 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&category=&publisher=&type=LEGALPOLICY&coi=HRV&rid=&docid=438ec8aa2&skip=0 (consulté le 22.03.2013).
12 Cécile Dubernet. Quand l’espace humanitaire devient une zone de guerre : personnes déplacées et peurs sécuritaires. Recueil Alexandries, Collections Esquisses, janvier 2006 http://www.reseau-terra.eu/article346.html (consulté le 23.03.2013).
13 Les données sont tirées de la pratique acquise, au fil des années, par l’auteur comme expert du Comité international de la Croix-Rouge.
14 Cécile Dubernet, op. cit.
15 Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays http://www.law.georgetown.edu/idp/french/GPFrench.pdf (consulté le 27.03.2013).